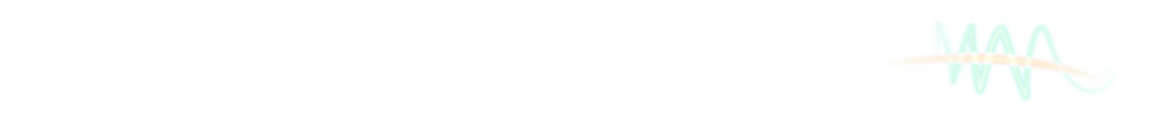Commençons franchement : la question revient tout le temps. “Est-ce que ma religion me rejette parce que j’aime une personne du même sexe ?” Et ça fait mal de se la poser. Surtout quand on a grandi dans une foi qu’on aime, avec des rituels, une communauté, une histoire… et qu’on se retrouve face à un mur dès qu’on parle d’homosexualité.
Alors, on a voulu faire un vrai point. Un truc clair, sans détour, sans langue de bois. Parce qu’il y a trop de flou, trop de “ça dépend”, trop de jugements balancés sans nuance. Et franchement, trop de souffrance aussi.
Le christianisme : entre rejet officiel et tolérance officieuse
C’est probablement là que le choc est le plus violent pour beaucoup. L’Église catholique, en 2024 encore, considère les actes homosexuels comme “désordonnés”. Ouais, le mot fait froid dans le dos. Pourtant, elle rappelle aussi qu’il faut accueillir les personnes homosexuelles “avec respect, compassion et délicatesse”. Mais honnêtement… on le sent ce double discours, non ?
Côté protestantisme, c’est plus varié. Certaines Églises (comme l’Église protestante unie de France) bénissent désormais les couples de même sexe. D’autres restent fermées. C’est du cas par cas, parfois même au sein d’une même ville. J’ai déjà vu deux temples à 200 mètres de distance, l’un ouvert, l’autre hostile.
Et les évangéliques ? Là c’est souvent plus rigide. Dans beaucoup de courants évangéliques, l’homosexualité est vue comme un péché. Point. Avec parfois des “thérapies” de conversion en bonus. Inhumain.
L’islam : un tabou puissant, mais pas une seule vision
Franchement, dans les sociétés majoritairement musulmanes, l’homosexualité est encore largement criminalisée. 64 pays dans le monde interdisent les relations entre personnes du même sexe, et une bonne partie d’entre eux sont à majorité musulmane. Mais est-ce que ça veut dire que l’islam rejette totalement les personnes LGBTQ+ ? Pas si simple.
Le Coran ne parle pas directement d’homosexualité telle qu’on la comprend aujourd’hui. Il y a l’histoire du peuple de Loth, souvent interprétée comme une condamnation. Mais de plus en plus de chercheurs musulmans queer ou alliés remettent ça en question. Ils disent : et si c’était une histoire de viol, de domination, de refus de l’hospitalité, et pas de relations consenties entre personnes du même sexe ?
Des figures comme Ludovic-Mohamed Zahed, imam ouvertement gay, ou des collectifs comme “Homosexuel·les Musulman·es de France” existent. Et ils montrent qu’un islam inclusif, ça n’est pas juste un rêve. C’est en train d’émerger, lentement, mais sûrement.
Le judaïsme : un éventail de positions, vraiment
Ce qui m’a surpris, perso, c’est à quel point le judaïsme est pluriel sur ce sujet. Dans le judaïsme orthodoxe, les relations homosexuelles restent interdites, point final. C’est rigide, souvent très dur à vivre.
Mais dans le judaïsme libéral ou réformé, c’est une autre histoire. Certains courants bénissent les mariages entre personnes de même sexe depuis plus de 15 ans. Aux États-Unis, le mouvement “Reconstructionist Judaism” a même ordonné des rabbins ouvertement gays dès les années 90. Ça calme.
Et en France ? Le judaïsme libéral (comme celui de MJLF à Paris) accueille largement les couples LGBTQ+, même si ça reste minoritaire dans le paysage global.
Et les spiritualités alternatives ?
Là, on respire un peu. Chez les bouddhistes, par exemple, il n’y a pas de condamnation officielle de l’homosexualité. Ce qui compte, c’est la qualité de la relation, la bienveillance, l’absence de souffrance. Des maîtres comme le Dalaï Lama ont eu des positions nuancées, parfois floues, mais globalement non hostiles.
Dans les cercles néo-païens, wiccans, ou dans certaines pratiques chamaniques modernes, la diversité des identités et des orientations est souvent vue comme sacrée. Il existe même des rituels LGBTQ+ spécifiques. Perso, j’ai assisté à une cérémonie queer-pagan dans les Cévennes… un feu de camp, des chants, une reconnaissance collective des blessures et des joies. Intense.
Alors, que retenir ?
Aucune religion n’est monolithique. Même dans les courants les plus stricts, il y a des voix qui s’élèvent, des gens qui résistent, des textes qu’on relit différemment.
Mais soyons lucides : le rejet reste puissant. Et il fait des dégâts. Beaucoup de personnes queer quittent leur religion à cause de ça. D’autres restent, mais dans la clandestinité. Et puis il y a celles et ceux qui reconstruisent une spiritualité à leur image. Qui recollent les morceaux, qui inventent d’autres chemins.
Et toi ? Est-ce que tu t’es déjà senti·e en porte-à-faux entre ce que tu es et ce qu’on t’a appris à croire ? Est-ce que tu cherches encore une place, un langage spirituel qui te ressemble ?
Si oui, sache un truc : t’es pas seul·e. Vraiment pas.